L'UER propose à ses membres une large gamme de services couvrant nos trois piliers stratégiques : stratégie et transformation, réglementation et plaidoyer, et contenu et distribution. Parcourez nos pages de services pour en savoir plus.
Les pages thématiques rassemblent sur une seule page tous les événements, groupes, ressources et contacts de l'UER liés à un sujet spécifique. Si vous les aimez, assurez-vous de les ajouter à vos favoris.
Toutes les thématiquesLes connaissances produites par l'UER aident les professionnels des médias à prendre des décisions cruciales et à se tenir au courant des tendances du secteur. Explorez nos différents formats : conférences vidéo, guides, recherches, études de cas et publications techniques.
Trouvez tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'UER. Non seulement nos pages À propos vous aident à comprendre notre histoire et notre objectif, mais elles offrent également un accès facile à nos offres d'emploi, des points de contact et bien plus encore.
À propos de l'UERL'anglais et le français sont disponibles dans le menu. Pour accéder à d'autres langues, cliquez sur l'icône de traduction en bas à droite de votre écran. Cette innovation fait partie de nos efforts visant à rendre le contenu de l'UER aussi accessible que possible à tous les membres.
L'équipe des Affaires juridiques et publiques de l'UER plaide pour l'instauration du cadre réglementaire le plus favorable aux médias de service public, aux niveaux national, européen et international. Elle dispense ses conseils juridiques aux Membres sur tous les grands enjeux du moment et dans des domaines tels que la gouvernance et le droit des médias, la propriété intellectuelle et les contrats commerciaux, pour ne citer qu'eux.
Pour rester au courant de l'actualité européenne et de nos dernières prises de position, suivez @EBU_Policy
Consultez les faits marquants de l’année écoulée et découvrez comment nous relevons le défi de défendre les médias de service public à travers toute l’Europe.
Voir plus !Liberté d'expression, protection des journalistes, publicité à caractère politique, poursuites stratégiques contre la mobilisation publique (SLAPP).
En savoir plus
Les médias de service public (MSP), lorsqu’ils sont florissants, défendent la liberté d’expression et le droit à l’information, tout en donnant aux journalistes les moyens de répondre à des exigences de qualité très élevées. Ils permettent aux individus de rechercher et de recevoir des informations, et soutiennent les valeurs de la démocratie, de la diversité et de la cohésion sociale.
Garantir l’indépendance des médias
L’un des plus grands défis auxquels les médias de service public sont confrontés consiste à s’assurer un niveau adéquat d’indépendance vis-à-vis du pouvoir économique et politique, tout en obtenant un financement approprié. La structuration et la définition de la mission conférée aux MSP relèvent de la compétence nationale. Les initiatives de l’UE sur l’indépendance et le renforcement de la transparence en matière de propriété des médias ne doivent pas entraver la capacité d’agir des États membres, mais plutôt compléter les règles nationales applicables.
Des structures de gouvernance indépendantes et durables
Pour être indépendants vis-à-vis des intérêts politiques et commerciaux, les médias de service public ont besoin d’un financement stable et pérenne, associé à des structures de gouvernance transparentes. Bien qu’il n’existe pas d’approche unique au niveau des pays concernant la mise en place d’organismes de médias de service public, les structures de gouvernance doivent néanmoins reposer sur les principes fondamentaux de l’indépendance, de la responsabilité et de la durabilité.
Protection du journalisme
Les journalistes et les professionnel.le.s des médias sont de plus en plus exposé.e.s à l’hostilité, au harcèlement et à la violence, tant en ligne que sur le terrain. L’indépendance éditoriale des organismes de médias doit impérativement être protégée. Les initiatives juridiques de l’UE concernant la protection des journalistes doivent s’inscrire dans le droit fil des normes du Conseil de l’Europe. Voir les travaux que nous menons sur la sécurité des journalistes.
Pour en savoir plus sur nos prises de position, consultez nos dernières nouvelles concernant la liberté et le pluralisme des médias.


Directive « Services de médias audiovisuels » (SMA), degré de visibilité, intégrité du contenu, équité.
En savoir plus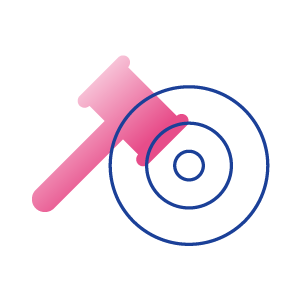
La directive « Services de médias audiovisuels » (SMA) pose le cadre juridique dans lequel s’inscrivent les principes fondamentaux d’un paysage audiovisuel florissant en Europe.
Assurer une visibilité appropriée aux contenus d’intérêt général, partout
La directive SMA permet aux autorités de régulation nationales de prendre des mesures pour garantir la visibilité des contenus et services d’intérêt général. Les fabricants de téléviseurs, les agrégateurs de services de médias audiovisuels et les plateformes en ligne ont tout intérêt à attirer le public vers des contenus qui servent leurs intérêts commerciaux, ce qui engendre un risque de marginalisation des contenus et services d’intérêt général. Les législateurs nationaux doivent donc moderniser les règles visant à garantir la visibilité des contenus et services des médias de service public, ainsi que leur accessibilité.
Protéger l’intégrité des contenus
Selon la directive SMA, les programmes et services de médias audiovisuels ne devraient pas subir de modification, d’interruption ou de superposition par des tiers, à des fins commerciales, sans le consentement explicite du fournisseur de services de médias. En ce qui concerne l’intégrité des contenus, nous encourageons les législateurs nationaux à adopter des règles exhaustives et probantes.
Renforcer la responsabilité des fournisseurs en ligne et promouvoir l’équité
En ce qui concerne les règles fondamentales relatives à la publicité, la directive SMA confère de nouvelles responsabilités aux fournisseurs de services des plateformes de partage de vidéos. Nous estimons que ces nouvelles règles constituent une première étape importante pour renforcer la responsabilité de ces fournisseurs et promouvoir l’équité au sein du secteur audiovisuel européen, à condition cependant qu’elles soient appliquées de manière efficace et cohérente. Nous plaidons toutefois pour un renforcement de la régulation des plateformes en ligne, ces dernières influant sur la recherche de contenus et services audiovisuels en ligne.
Pour en savoir plus sur nos prises de position, consultez nos dernières nouvelles concernant la réglementation des contenus médiatiques.


Attribution à la marque, accès aux données, traitement préférentiel (self-preferencing), transparence des algorithmes, concurrence, règlement « plateforme-entreprise ».
En savoir plus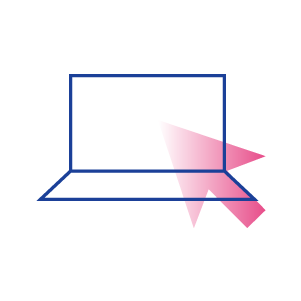
Pour toucher tous les segments de la société, les médias de service public (MSP) s’appuient de plus en plus sur les plateformes en ligne, ce qui pose plusieurs problèmes.
Modération du contenu
Se référant à leurs propres politiques en la matière, les plateformes en ligne retirent le contenu des MSP ou limitent sa visibilité, privant de ce fait les utilisateur.rice.s de contenus fiables dont l’élaboration est déjà encadrée. Il faudrait par conséquent que l’UE instaure de solides garanties de procédure, offrant aux MSP des recours efficaces contre toute décision de modération du contenu qui serait injustifiée ou mal étayée.
Attribution à la marque
Les plateformes en ligne doivent faire en sorte que l’identité des organismes de médias figure de façon visible sur le contenu qu’elles proposent, afin que les utilisateur.rice.s puissent faire leur choix en toute connaissance de cause.
Transparence des algorithmes
Pour que les MSP puissent comprendre les modalités de classement de leurs contenus et services sur les plateformes, il convient de renforcer les processus décisionnels en matière d’algorithmes et de recommandation de contenu des plateformes en ligne.
Visibilité
Pour que les citoyen.ne.s accèdent facilement aux contenus et services en ligne des MSP, les législateurs européens doivent veiller à ce que les plateformes assurent la visibilité des contenus et des services d’intérêt général.
Accès aux données
À l’ère numérique, les données sont une ressource cruciale. Les MSP doivent obtenir un accès garanti aux données relatives à leurs propres contenus et services publiés sur les plateformes.
Traitement préférentiel
L’UE devrait lutter contre toutes les formes de traitement préférentiel, ou self-preferencing, pratique selon laquelle les plateformes classent leurs propres services de manière plus favorable que ceux de leurs concurrents.
La loi sur les services numériques (DSA), la loi sur les marchés numériques (DMA) et le règlement « plateforme-entreprise » sont autant de mesures prises par les législateurs européens pour lutter contre l’influence croissante des plateformes en ligne. Ces efforts doivent se poursuivre, si l’on veut que les MSP puissent fonctionner librement et conserver leur pertinence pour leurs utilisateurs et utilisatrices en ligne.
Pour en savoir plus sur nos prises de position, consultez nos dernières nouvelles concernant les plateformes en ligne.




Règlement général sur la protection des données (RGPD), règlement « Vie privée et communications électroniques », intelligence artificielle (IA), règlement sur la gouvernance des données, loi sur les données.
En savoir plus
Les activités de collecte et d’utilisation des données sont devenues primordiales pour mieux comprendre les attentes et les besoins des publics, et donc pour améliorer la qualité globale et la diversité de l’offre médiatique. Saisir de nouvelles possibilités en matière de données tout en protégeant les données à caractère personnel est l’un des plus grands défis auxquels les organismes de médias sont actuellement confrontés.
Dans le cadre de la mission qui leur est conférée, il incombe tout particulièrement aux médias de service public (MSP) de faire en sorte que les données soient recueillies, conservées et traitées de la façon la plus responsable possible, conformément aux lois européennes et nationales applicables.
Règlement général sur la protection des données (RGPD)
Les MSP sont favorables à une application cohérente et efficace du RGPD, qui permette de préserver la vie privée des personnes et la sécurité juridique des organismes, en particulier lorsque les données à caractère personnel sont traitées à l’extérieur de l’EEE, dans des pays tiers non couverts par une décision d’adéquation de l’UE. En plus d’autres grands enjeux liés au respect du RGPD, tels que la sécurité des données, les obligations du responsable du traitement et du sous-traitant, et les droits des personnes concernées, l’UER s’attache également à préserver un équilibre délicat entre le droit à la protection des données à caractère personnel et le droit à la liberté d’expression et d’information, afin d’éviter de créer un effet paralysant sur les activités des journalistes.
Vie privée et communications électroniques
Le règlement « Vie privée et communications électroniques » vise à harmoniser les exigences en matière de consentement et les règles d’utilisation des cookies aux fins du suivi de l’activité en ligne. L’UER soutient les exemptions du consentement aux cookies, ainsi que la mise en place d’un système de mesure de l’audience probant.
Intelligence artificielle (IA)
Les médias de service public élaborent et utilisent des outils basés sur l’intelligence artificielle à l’appui du travail journalistique et de la promotion de la diversité, ainsi que pour optimiser l’organisation des tâches. Du fait de leur nature et de la mission qui leur est dévolue, les MSP s’engagent à appliquer les normes éthiques et technologiques les plus élevées pour protéger et informer les citoyen.ne.s.
Pour en savoir plus sur nos prises de position, consultez nos dernières nouvelles concernant les données et la protection de la vie privée.



Réseaux 5G, production sans fil, distribution en 5G, accès vertical, diffusion en 5G, neutralité du Net, services spécialisés.
En savoir plus
5G
L’UER et les médias de service public (MSP) font œuvre de pionniers en matière d’utilisation de la 5G à des fins de production et de distribution du contenu. Ils ont planché sur sa normalisation et lancé la coordination des parties prenantes des médias et des TIC avec le groupe 5G MAG.
L’UER appelle à instaurer des directives réglementaires appropriées et à effectuer les bons choix technologiques. L’industrie de la radiodiffusion devrait être en mesure de détenir et d’exploiter ses propres réseaux 5G à des fins spécifiques, notamment une infrastructure de production sans fil pour la couverture de manifestations en direct.
Il est également essentiel que la distribution du contenu à grande échelle grâce à la 5G soit techniquement et économiquement durable, afin que les MSP restent abordables et accessibles. La diffusion en 5G est donc mise en avant afin d’assurer la disponibilité des contenus des MSP sur tous les appareils mobiles, y compris par radiodiffusion, et de garantir un accès gratuit. En savoir plus sur la 5G.
Les publics doivent disposer d’un accès sans entrave, non discriminatoire et transparent aux contenus en ligne présentant un intérêt général. Les mesures visant à renforcer la transparence doivent être associées à une politique claire en matière de gestion du trafic sur internet, afin d’assurer un traitement égal pour tous les types de trafics équivalents.
Les autorités de régulation doivent empêcher l’apparition de nouvelles formes de discrimination liée au trafic, qui octroient aux seuls fournisseurs de contenus disposant de ressources suffisantes la possibilité de négocier des tarifs « préférentiels », ce qui fausse la concurrence, entrave l’innovation et limite le choix des utilisateur.rice.s.
La neutralité du Net doit être la norme et les services spécialisés l’exception, faute de quoi la capacité du réseau, qui a ses limites, risque d’être dominée par les services spécialisés, compromettant du même coup l’accès de chacun à l’internet ouvert.
Pour en savoir plus sur nos prises de position, consultez nos dernières nouvelles concernant la 5G et l'internet ouvert.



Financement des MSP, pérennité budgétaire, politique de concurrence, innovation, protocole d'Amsterdam.
En savoir plus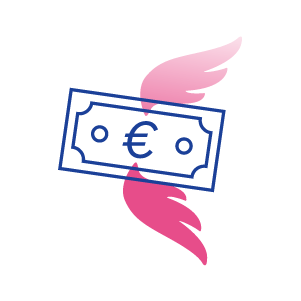
Le paysage médiatique évolue rapidement et s’éloigne des modes de diffusion traditionnels, pour entrer résolument dans l’« ère des plateformes ». Les règles relatives à la concurrence et aux aides d’État doivent tenir compte de la force de frappe des grands acteurs internationaux de l’audiovisuel et de leur impact sur le paysage médiatique européen, afin de donner aux MSP la possibilité d’innover et de concevoir les nouveaux services et contenus qui leur permettront de remplir leurs obligations en matière d’universalisme et de conserver toute leur pertinence.
Les modèles de financement des MSP
Ces modèles de financement doivent permettre aux MSP de remplir leur mission d’intérêt public. Les États doivent offrir un soutien financier adéquat à leurs médias publics, afin que ceux-ci puissent bénéficier à tou.te.s les citoyen.ne.s et assumer pleinement leur rôle, qui consiste à promouvoir la démocratie, la cohésion sociale et les valeurs culturelles.
Un financement suffisant, stable et pérenne
Un financement insuffisant et fluctuant est préjudiciable à la qualité des programmes et de l’information en particulier, expose les MSP aux influences commerciales et politiques et diminue leur capacité à investir dans des offres, des technologies et des talents nouveaux.
Donner aux médias de service public la liberté d’innover
Le droit de la concurrence et la réglementation en matière d’aides d’État doivent permettre aux médias européens de service public d’innover et de coopérer, afin d’être en mesure de rivaliser avec leurs concurrents non européens sur le marché audiovisuel.
Soutenir le double système européen de radiodiffusion
Ce modèle, reconnu dans de nombreux textes internationaux et décisions de justice, garantit une concurrence efficace entre médias de service public et médias privés.
Pour en savoir plus sur nos prises de position, consultez nos dernières nouvelles concernant la concurrence et le financement.


Propriété intellectuelle (PI), liberté et territorialité en matière de contrats, cadres réglementaires international et communautaire.
En savoir plus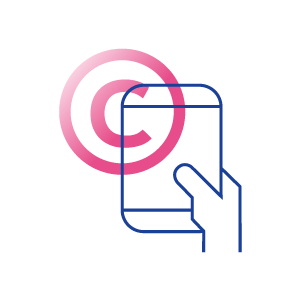
Les médias de service public (MSP) investissent chaque année 18 milliards d’euros dans des contenus européens originaux, auxquels contribuent un grand nombre de personnes. Celles-ci ont donc droit à une rémunération pour l’utilisation de ces contenus et l’octroi des licences y afférentes.
Des contenus de qualité
Les MSP étant à la fois titulaires et utilisateurs de droits, il est crucial que le cadre européen régissant le droit d’auteur puisse leur donner la possibilité de s’acquitter de leur mission nationale, à savoir, offrir à la population des contenus et des services de qualité. En tant que partenaire de l’Union européenne, l’UER apporte à ses Membres des conseils et un soutien juridiques dans le cadre de la mise en œuvre de la législation européenne.
Flexibilité contractuelle
L’UER plaide pour la mise en place d’un environnement qui facilite la distribution des contenus à grande échelle, ainsi que l’accès à ces derniers, tout en protégeant les créateur.rice.s artistiques. Préserver la flexibilité contractuelle permet aux titulaires et aux utilisateur.rice.s de droits de négocier comment, quand et où les contenus sous licence sont proposés, afin de répondre au mieux aux attentes des consommateur.rice.s. La possibilité d’exploiter des programmes audiovisuels, selon le principe de territorialité et sur une base exclusive, repose sur cette flexibilité. La territorialité est un atout pour le financement des œuvres européennes ; sa suppression limiterait les choix proposés au public et favoriserait les plus grands utilisateurs de droits d’auteur.
OMPI
Le niveau actuel de protection est insuffisant pour lutter efficacement contre le piratage dont les contenus audiovisuels peuvent faire l’objet. Les MSP soutiennent activement l’élaboration, par l’OMPI, d’un traité sur la protection des organismes de radiodiffusion et encouragent vivement les États membres de l’OMPI à adopter dans un avenir proche un instrument international à l’épreuve du temps.
Pour en savoir plus sur nos prises de position, consultez nos dernières nouvelles concernant le droit d'auteur et les droits voisins.


Fréquences, télévision numérique terrestre (TNT), partie inférieure de la bande UHF (470-694 MHz), sous-bande 700 MHz, CMR, RSPG, dividende numérique, services PMSE.
En savoir plus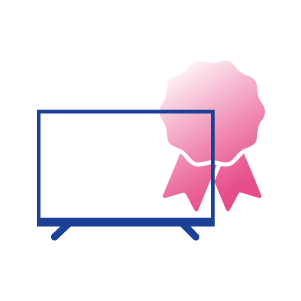
Le spectre est la gamme des radiofréquences utilisée pour la transmission sans fil des données. Il est divisé en différentes bandes. La partie inférieure de la bande UHF (c.-à-d. les fréquences de 470 à 694 MHz) est celle qu’utilisent les médias de service public pour mettre à la disposition du public, en clair, la télévision numérique terrestre (TNT). Cette partie est partagée avec les services de réalisation de programmes et d'événements spéciaux (PMSE) depuis des décennies.
Une ressource rare
Le spectre est en train de se raréfier, en raison du développement croissant des technologies sans fil. Il y a peu, les radiodiffuseurs ont investi pour libérer une portion importante du spectre qu’ils utilisaient. Ce faisant, ils ont élargi les possibilités de choix s’offrant aux spectateur.rice.s, tout en améliorant la qualité des programmes télévisés. Cette portion du spectre est à présent allouée aux services mobiles à large bande (ce que l’on appelle le « dividende numérique »). Un éparpillement ultérieur des ressources en spectre au détriment des radiodiffuseurs compromettrait l’accès universel aux MSP car en réalité, cela signerait la fin de la TNT. Sur le plan de la production, cela signifie en outre que les services PMSE devraient attribuer une autre bande aux microphones sans fil, réseaux d’ordres (talk-back) et systèmes intra-auriculaires utilisés au quotidien pour couvrir les événements politiques, religieux, sportifs, culturels et locaux.
Protéger la radiodiffusion
L’UER s’emploie sans relâche à garantir une quantité suffisante de spectre à la TNT et à préserver le dynamisme du paysage audiovisuel européen. Dans le cadre de la prochaine Conférence mondiale sur les radiocommunications (CMR-23) de l’UIT, en particulier concernant le point 1.5 de l’ordre du jour, l’UER exhorte les négociateurs à protéger l’utilisation actuelle du spectre par la TNT et les services PMSE dans la partie inférieure de la bande UHF, ce qui s’inscrirait dans le droit fil des compromis très équilibrés trouvés au niveau européen.
Pour en savoir plus sur nos prises de position, consultez nos dernières nouvelles concernant le spectre.



C'est en concertation avec les Membres de l'UER, ainsi qu'avec l'Assemblée et le Comité des Affaires juridiques et publiques et nos groupes d'experts, que l'équipe des Affaires juridiques et publiques définit les prises de position de notre Union. Vous avez la possibilité de consulter les archives documentaires de notre Assemblée des Affaires juridiques et publiques, qui remontent à 1999.
La liberté des médias et l'existence même des médias de service public sont menacées en Europe. Les responsables politiques européens peuvent toutefois agir pour inverser cette tendance et l’EBU souhaite les soutenir dans cette démarche.
Dans cette publication, vous trouverez les priorités de l'UER pour le nouveau mandat des institutions européennes:
Il est nécessaire que les responsables politiques prennent position en faveur d’un secteur des médias diversifié et pluraliste en Europe. L'UE a besoin de politiques qui soutiennent la capacité des citoyens à accéder à des informations fiables et à bénéficier de médias de qualité....
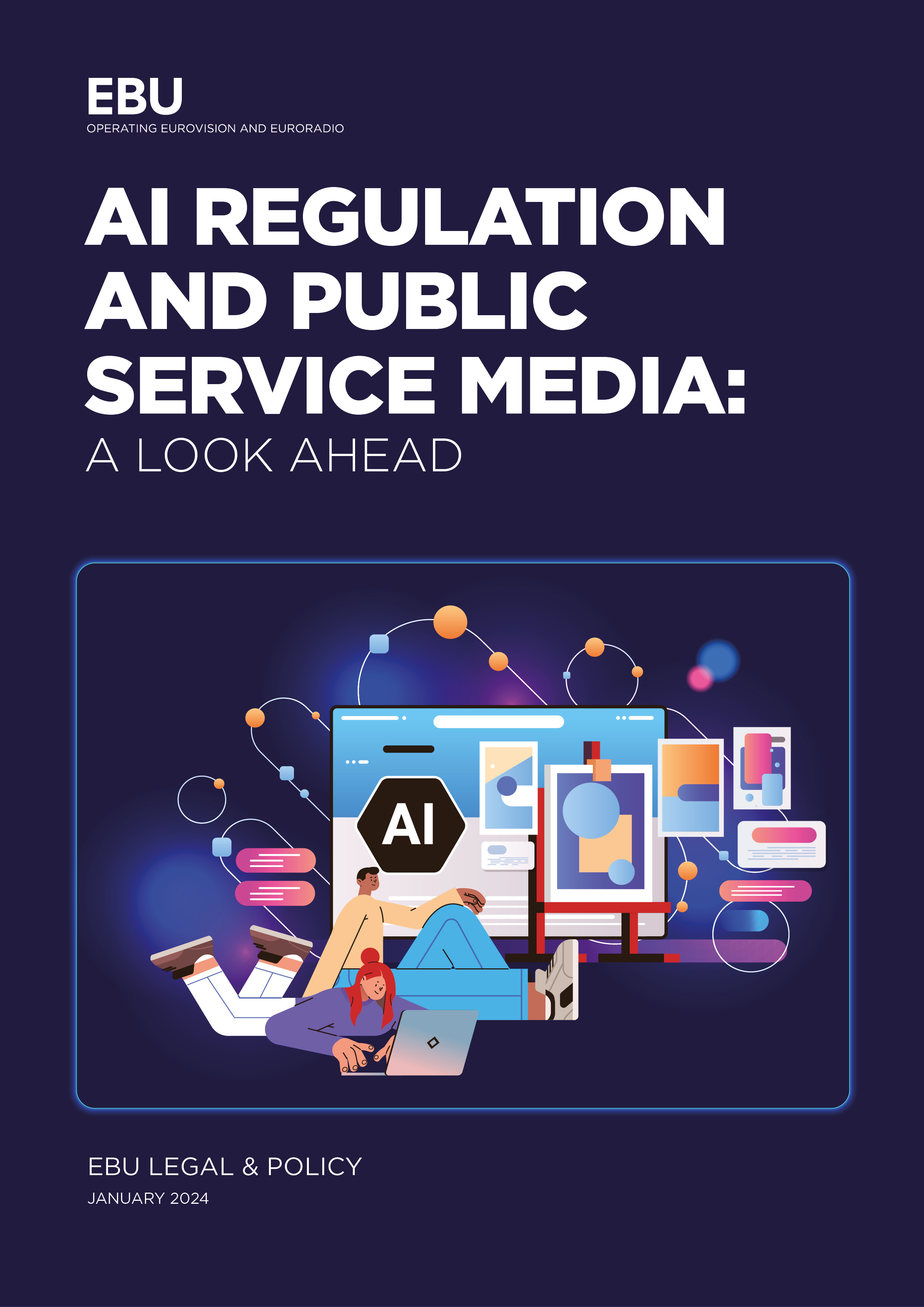
In Europe, we are currently witnessing a scramble for artificial intelligence (AI) regulation, both nationally and internationally. The European Union (EU) is finalising a proposal to establish common rules and obligations for providers and deployers of AI-based systems in the EU internal market. In parallel, the Council of Europe (CoE), a different inter-governmental organisation made up of 46 member states, including the 27 EU member states, is negotiating an international treaty – the so-called “Framework Convention” – on the development, design and application of AI systems based on the Council of Europe’s standards on human rights, democracy and the rule of law. The Framework Convention is expected to become the leading global normative instrument for AI, as states such as the United States, Canada, Israel and Japan have committed to ratifying it.
At present, the main challenge of AI regulation is to foster innovation and encourage the use of AI while protecting fundamental rights. This is why the EU and the Council of Europe are proposing a "risk-based" approach,...
L’accès en ligne aux contenus éditoriaux a évolué, le public s’appuyant désormais sur des plateformes et des appareils appartenant à des tiers. Cependant, la présentation des contenus de médias est largement entre les mains d’intermédiaires, qui négligent souvent d’attribuer le contenu à sa source, parfois même en masquant intentionnellement l’identité des médias concernés.
Il est donc parfois difficile, pour le public, d’identifier l’origine des contenus et de faire le tri entre sources crédibles et sources sensationnalistes. Cette distorsion de la perception peut influencer les opinions et entraver l’émergence d’une société éclairée, ce qui au bout du compte, entraîne des répercussions négatives sur la liberté et le pluralisme des médias.
Téléchargez notre publication pour en savoir plus.
Si elle est adoptée, la proposition de la Commission européenne concernant une directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité (CDDD) obligerait les entreprises à mettre en place des procédures liées au devoir de vigilance (ou « diligence raisonnable ») pour pallier les effets négatifs de leurs activités sur les droits humains et l’environnement, et ce, tout au long de leurs chaînes de valeur. Le but est de favoriser un comportement durable et responsable et d’engager une réflexion sur la durabilité au sein des opérations et de la gouvernance des entreprises.
La directive s’inscrit dans le cadre du Pacte vert pour l’Europe — une série d’initiatives politiques de la Commission...
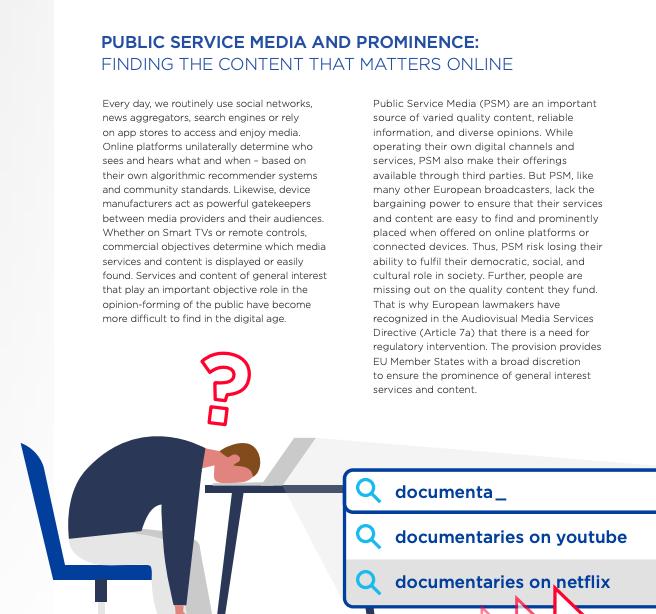
Dans le monde en ligne actuel, ce sont les grandes plateformes technologiques qui déterminent arbitrairement qui voit quoi et à quel moment, en se basant sur leurs propres algorithmes de recommandation et leurs normes communautaires. Les fabricants d’appareils endossent eux-mêmes un rôle de contrôleurs d’accès, entre les médias et leur public. Qu’il s’agisse de téléviseurs intelligents ou de télécommandes, ce sont les objectifs commerciaux qui déterminent quels services et contenus de médias sont affichés ou facilement accessibles.
Les médias audiovisuels publics offrent un très large éventail de contenus, d’informations fiables et d’opinions diverses. Mais, comme beaucoup d’autres diffuseurs européens, ils ne disposent pas du pouvoir de négociation nécessaire pour veiller à ce que leurs services et leurs contenus soient faciles à trouver et bien visibles sur les plateformes en ligne ou les appareils connectés.
Téléchargez notre publication pour en savoir...
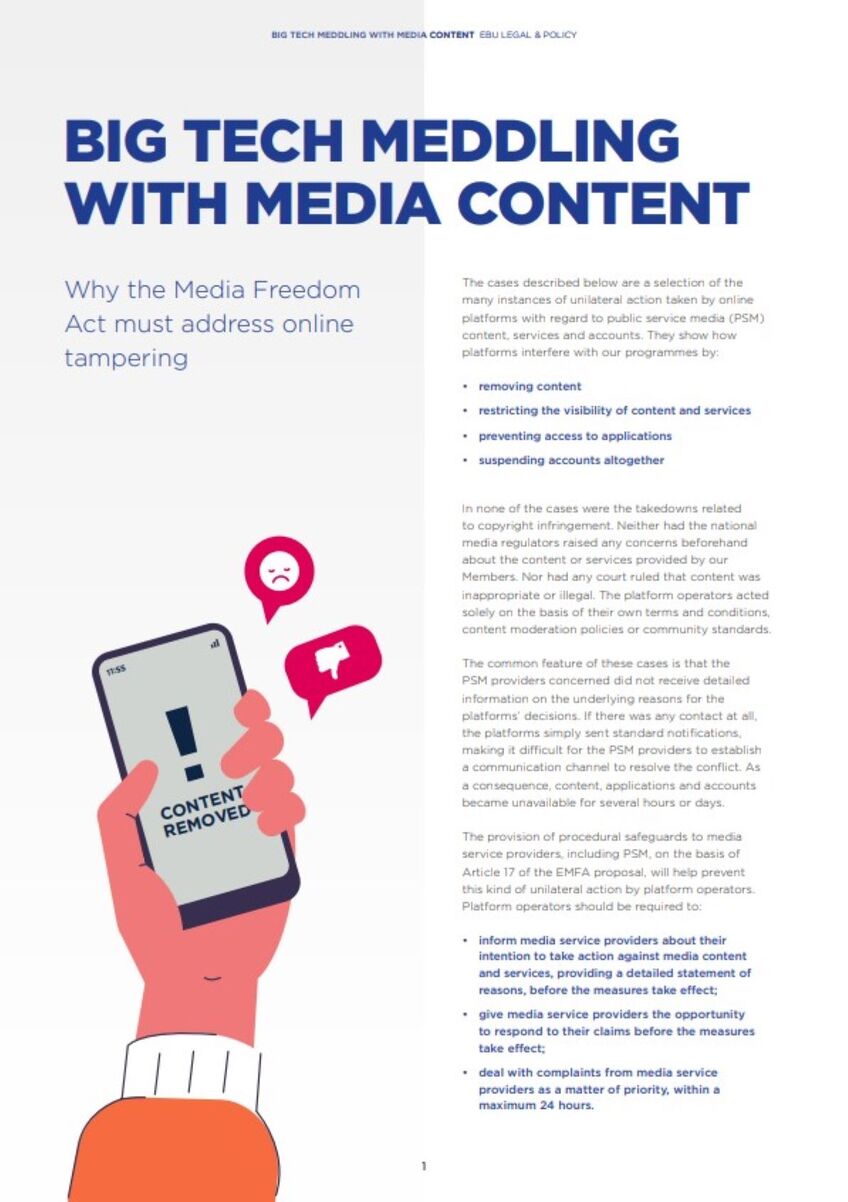
De nos jours, l’accès aux contenus audiovisuels et sonores passe de plus en plus par des appareils numériques et des interfaces utilisateur.
Dans le paysage audiovisuel actuel, caractérisé par une très forte concurrence, les applications et les services risquent de perdre leur pertinence aux yeux du public s’ils ne sont pas facilement accessibles. Il en résulte une lutte pour la visibilité des contenus, qui menace les fournisseurs de services de médias et l’accès des citoyen.ne.s à des médias diversifiés, à des informations fiables et à des contenus locaux.
Téléchargez notre publication pour en savoir plus sur les éléments qui influencent la visibilité des MSP et leur accessibilité par le public.
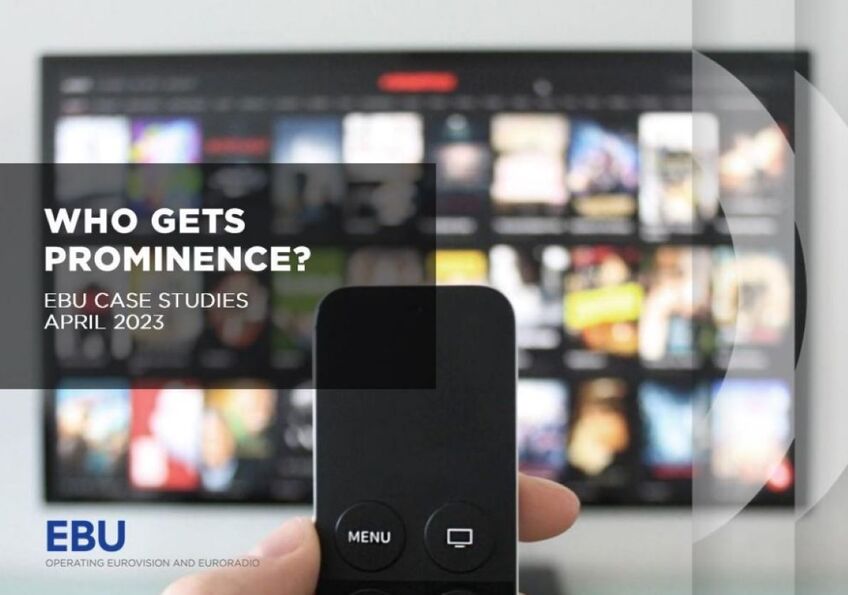
De nos jours, l’accès aux contenus audiovisuels et sonores passe de plus en plus par des appareils numériques et des interfaces utilisateur.
Dans le paysage audiovisuel actuel, caractérisé par une très forte concurrence, les applications et les services risquent de perdre leur pertinence aux yeux du public s’ils ne sont pas facilement accessibles. Il en résulte une lutte pour la visibilité des contenus, qui menace les fournisseurs de services de médias et l’accès des citoyen.ne.s à des médias diversifiés, à des informations fiables et à des contenus locaux.
Téléchargez notre publication pour en savoir plus sur les éléments qui influencent la visibilité des MSP et leur accessibilité par le public.
Cette version publique de notre manuel sur la nouvelle législation relative aux services numériques (DSA, Digital Services Act) a pour vocation d'expliquer les nouvelles règles mises en place par le DSA ainsi que les modes de collaboration que les médias de service public peuvent nouer avec les plateformes en ligne appartenant à des tiers, que ce soit sur le plan commercial, technique ou juridique. Ce manuel apporte en outre des réponses aux questions les plus pressantes que les MSP se posent concernant cette nouvelle législation.
Enfin, cette publication donne une vue d’ensemble des dispositions du DSA qui sont susceptibles d'affecter les activités des médias de service public et s’interroge sur les moyens de rééquilibrer les relations avec les plateformes en ligne.
Le guide de la législation sur les marchés numériques s’adresse aux Membres de l’UER. Il présente aux médias de service public les obligations et les interdictions visant les « contrôleurs d’accès numériques » qui sont prévues par cette législation.
Ce guide décrit tout particulièrement les principales dispositions et contraintes de mise en œuvre pour les MSP que l’UER a identifiées pendant la procédure législative.
Les non-Membres sont invités à contacter le secrétariat des Affaires juridiques de l’UER s’ils souhaitent obtenir un exemplaire de cet ouvrage.

La liberté et le pluralisme des médias sont des valeurs européennes fondamentales qui doivent être rigoureusement protégées. Or certaines menaces, telles que les ingérences gouvernementales, les atteintes à l’intégrité des journalistes, les pressions financières ou encore le rôle de « contrôleurs d’accès » endossé par certaines plateformes mettent ces valeurs en péril.
Nous accueillons donc positivement la législation européenne sur la liberté des médias (EMFA), qui reconnaît l’importance des médias dans la démocratie et soutient les médias de service public indépendants. Pour que l’EMFA protège l’indépendance des médias et l’accès en ligne, nous appelons les décideurs européens à clarifier les principes relatifs aux médias de service public et à renforcer les dispositions concernant les services d’intérêt général et l’influence des...
Destiné aux Membres de l’UER, notre manuel sur la législation relative aux marchés numériques (DMA, Digital Markets Act) entend définir les actions que les médias de service public doivent entreprendre, ainsi que celles qu’ils doivent au contraire éviter, dans le cadre de cette nouvelle loi.
Il met l’accent sur les dispositions les plus pertinentes et sur les obstacles à la mise en œuvre du DSA par le médias de service public, obstacles que l’UER a identifiés au cours du processus législatif.
Les organisations qui ne sont des Membres de l’UER sont invitées à contacter le secrétariat du département des Affaires juridiques et publiques de l'UER pour en obtenir un exemplaire.
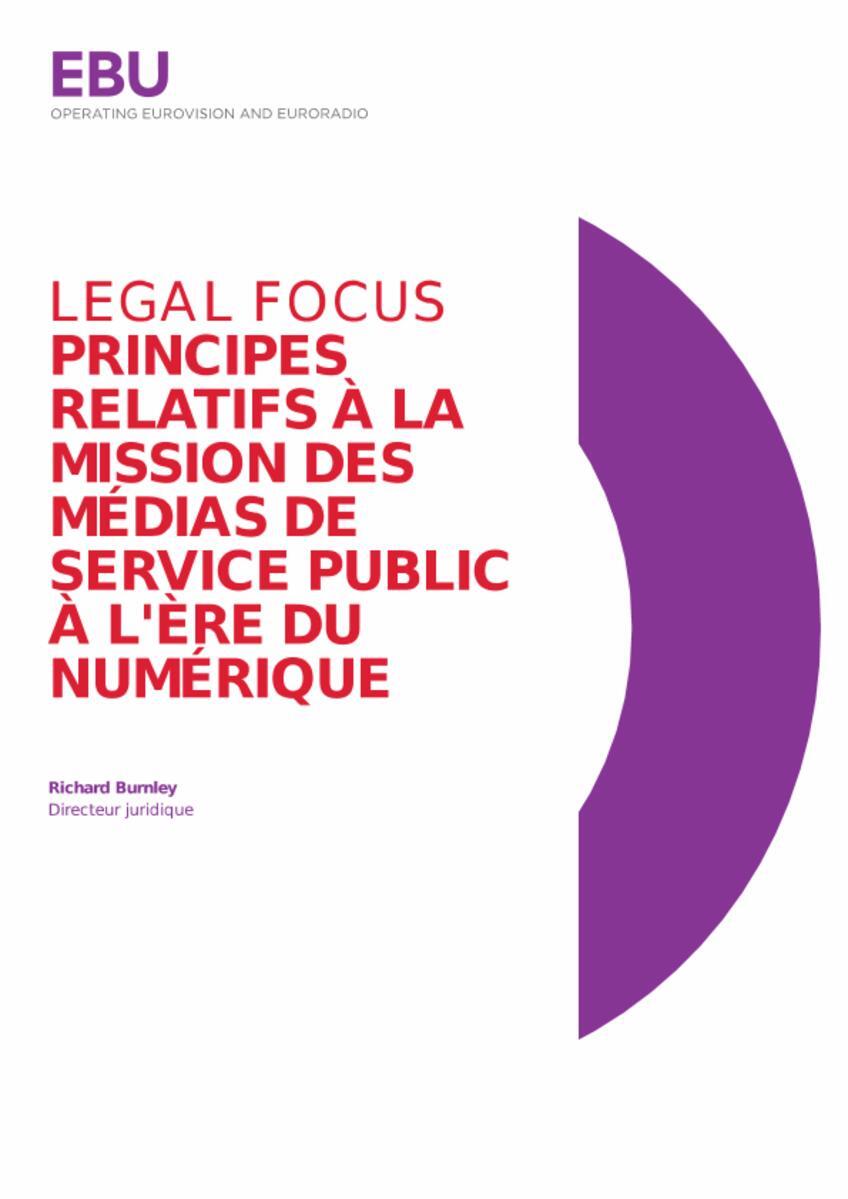
Le Legal Focus de l'UER sur les principes relatifs à la mission des médias de service public à l'ère du numérique traite de la question cruciale du rôle des médias de service public et de l'étendue de leurs activités sur les marchés des médias numériques internationaux.
Cette nouvelle publication aborde la problématique en proposant des principes non-contraignants pour la mission des MSP:
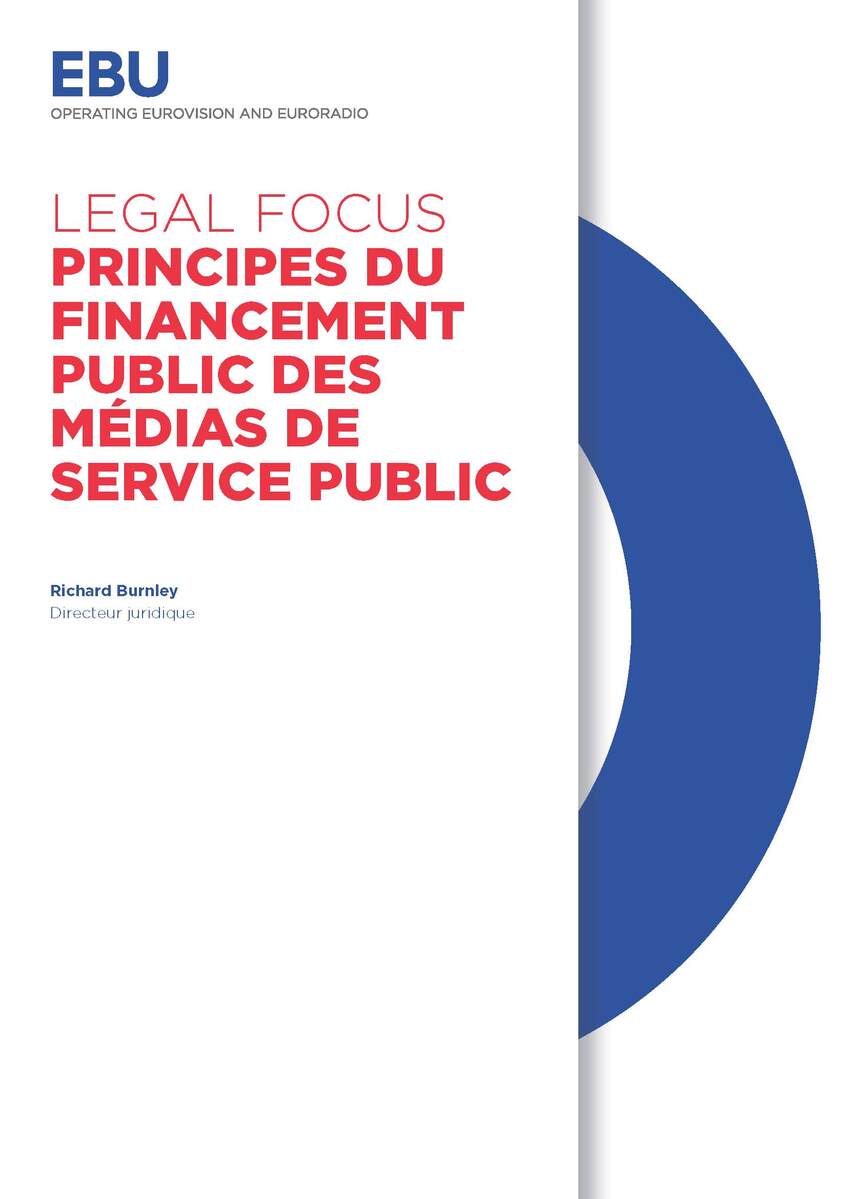
Intervenant à un moment critique qui voit le financement des MSP être mis à rude épreuve dans de nombreux pays, cette publication vise à leur fournir des éléments d'orientation et de référence en matière d'évaluation et d'application de modèles de financement nouveaux et existants. En Europe, la façon d'envisager le financement des MSP varie selon les pays et reflète les structures juridique, constitutionnelle, économique et culturelle propres à chacun d'eux. Il est cependant possible d'identifier un certain nombre de principes généraux dignes d'être pris en considération dans tous les débats portant sur le financement des MSP.
Le Legal Focus sur les principes du financement public des MSP s'appuie sur les Valeurs fondamentales des médias de service public que l'Assemblée générale de l'UER a adoptées à Strasbourg, en 2012.
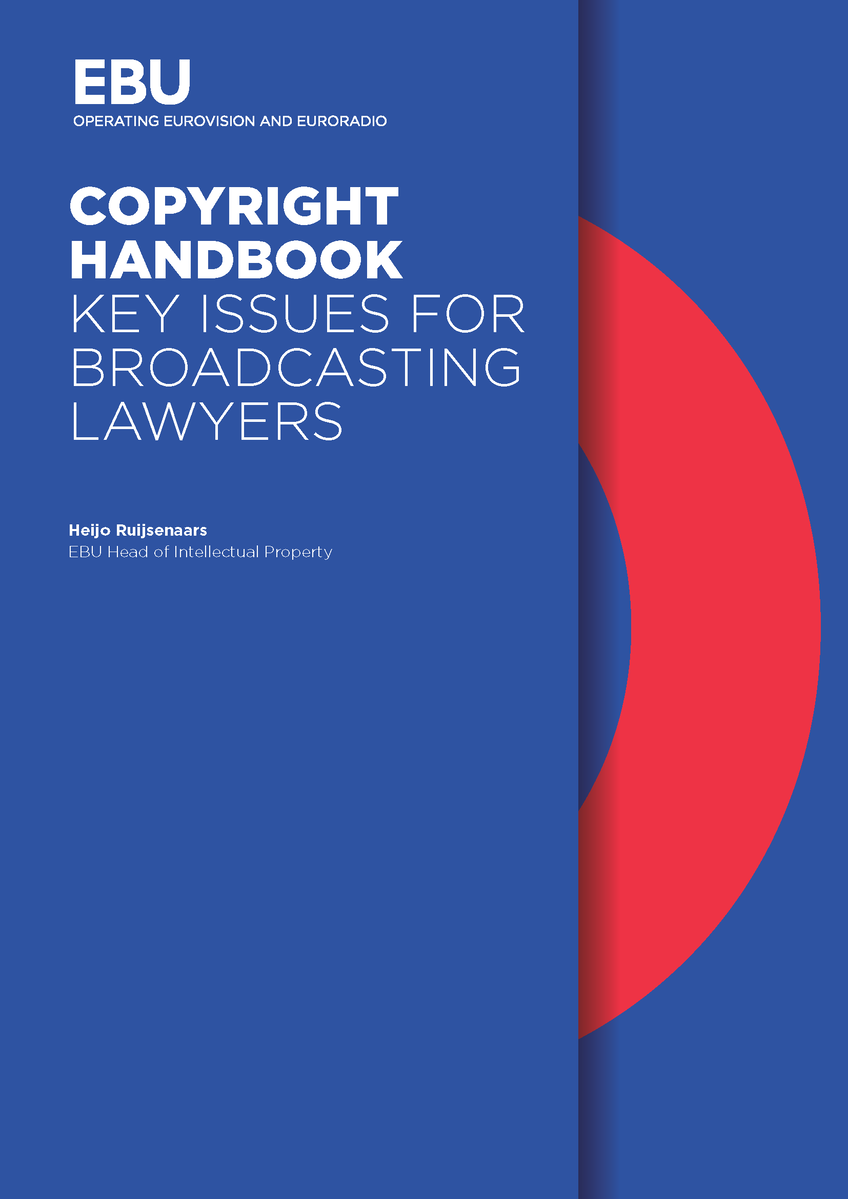
Avec son nouveau Manuel du droit d’auteur, l’UER fournit à ses membres un outil de référence traitant des principaux problèmes de droit d’auteur auxquels sont confrontés les radiodiffuseurs. Ce Manuel est complémentaire au Guide du droit d'auteur de l'UER, fournissant un aperçu de tous les sujets pertinents et une jurisprudence illustrative ainsi que des références juridiques pour améliorer la compréhension des questions de droit d’auteur dans la radiodiffusion.
Les non-membres sont invités à communiquer avec le secrétariat du département juridique de l'UER pour obtenir des renseignements sur la façon d’en obtenir un exemplaire.
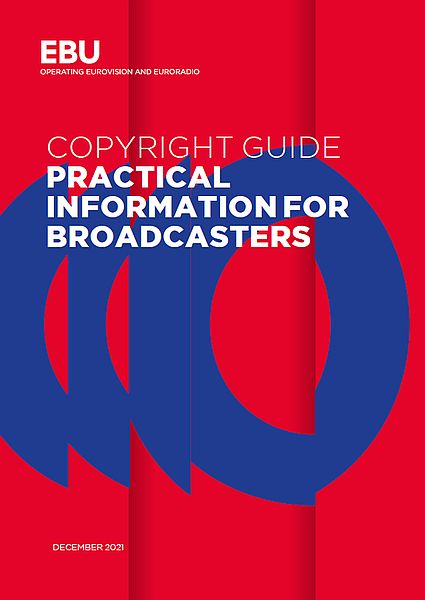
Le Département juridique de l’UER a publié une boîte à outils pratique à l’intention des éditeurs et des responsables de programmes travaillant pour des radiodiffuseurs de service public, dans le but de mieux faire connaître tous les droits et obligations en vertu de la loi sur le droit d’auteur à prendre en compte lors de la création, sélectionner et utiliser du matériel protégé.
Inscrivez-vous pour recevoir nos bulletins d'information réservés aux Membres. Le Legal and Policy Spotlight fait le point sur les activités menées par le département des Affaires juridiques et publiques de l’UER. Quant au bulletin News2Know, il offre un instantané quotidien des derniers développements intéressant les médias de service public. Les Membres ont également la possibilité de consulter notre base de données News2Know
Pour rester au courant de l'actualité européenne et de nos dernières prises de position, suivez @EBU_Policy
Contacter l'équipe des Affaires juridiques et publiques. Nous sommes à votre disposition !
Afficher tous les contacts (6)

Responsable du Service des affaires juridiques et commerciales
+41 22 717 27 72


Senior Executive Assistant & Membership Legal Secretary
+41 22 717 25 05